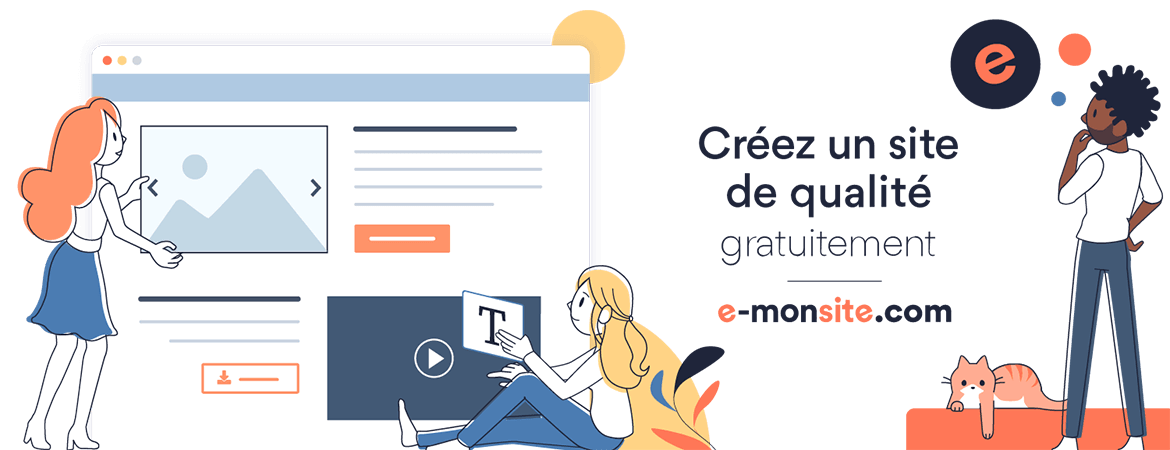Le développement durable : instrument de dialogue ou de domination Nord/Sud ?
- Par Administrateur ANG
- Le 09/05/2011 à 09:44
- 0 commentaire

Le développement durable, instrument de dialogue ou de domination Nord/Sud ? Des spécialistes de la question donnent leurs avis et parmi eux Serge MICHAILOF, Consultant international et enseignant à Sciences po, ancien directeur de la Banque mondiale et des opérations de l’Agence française de développement (AFD), qui explique que dans le contexte actuel, l’aide publique au développement ne doit plus être une œuvre de charité mais doit devenir un instrument de géopolitique et un instrument de dialogue Nord/Sud.
Luc LAMPRIÈRE, Directeur général d’Oxfam France
Je voudrais donner quelques idées sur le regard qu’une ONG comme Oxfam, qui travaille sur les questions de solidarité internationale et sur les enjeux de développement, porte sur le concept de développement durable. Celui-ci est intégré dans un certain nombre d’activités et de travaux. Il est intégré également au droit international et il y a des contextes dans lesquels on l’utilise puisqu’il s’applique comme un prisme, comme une façon de regarder le monde. Mais ce n’est pas forcément l’angle d’analyse et d’action que nous utilisons. Nous ne privilégions pas le langage du développement durable. On parle de développement, un développement que l’on souhaite équitable et respectueux des principes de justice et des droits des populations.
Je suis assez sensible à ce que dit Bertrand Méheust dans son livre provocateur sur La politique de l’Oxymore, à savoir que le développement durable est un bel oxymore. On aime bien l’idée que cela dure. Donc le fait que ce soit du développement, et qu’en plus ce soit durable, c’est un concept plutôt plaisant, confortable, qui a une capacité à rentrer dans le langage du marketing de façon très rapide. Il y a un jeu sur les mots, et on en oublie les principes de base. Il faut donc remonter un petit peu au départ du concept, c’est une idée relativement récente. Comme le dit le Rapport Brundtland, le développement durable est un « développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Deux concepts sont inhérents à cette notion : d’une part le concept de besoin, et plus particulièrement les besoins essentiels des plus démunis à qui il convient d’accorder la plus grande priorité. D’autre part l’idée d’un impact négatif de nos techniques et de notre organisation sociale sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir.
C’est un concept riche, qui peut nous permettre de construire un travail dans la dynamique Nord/Sud. Les réussites en matière de développement sont d’abord nationales, locales. Il apparaît paradoxal de faire ce constat alors que nous venons de parler de la mondialisation, mais pour la majorité de la population du monde, ce sont des problèmes locaux auxquels il s’agit de faire face. On sait que le changement climatique est une dynamique globale alimentée en grande partie par les comportements des sociétés industrialisées comme en Europe, mais si on parle changement climatique par exemple au Mali, les gens font le lien avec les problématiques locales, en l’occurrence la consommation de bois, la manière de couper les arbres… Dans les pays du Sud, on intériorise une réalité propre, locale. Je pense que c’est d’ailleurs une leçon d’humilité par rapport à notre absence de responsabilité.
Oxfam privilégie une approche citoyenne des problématiques locales. Notre préoccupation est de savoir si les populations sont bien au centre du débat dans les processus d’orientation des politiques et de prise de décision. Le PNUD est l’organisation internationale qui couvre ce champ, notamment par la publication annuel de son rapport sur le « développement humain ». Le rapport anniversaire de 2010, le 20e, est l’occasion pour le PNUD de se demander si ce concept fonctionne toujours. Ce n’est pas une révolution majeure de ce concept qui est proposée, mais plutôt élargie : le développement humain est la capacité d’étendre les libertés réelles, les capacités des êtres humains, de leur donner le pouvoir d’être des agents actifs au développement équitable sur une planète partagée. Mais pour de vrais changements, il faut une capacité de mobilisation locale. L’Afrique par exemple n’attend pas des réponses de la part du Nord pour évoluer. Il y a une richesse des sociétés africaines, des médias africains, qui constituent autant d’espaces d’expression politique et de force de proposition, conditions indispensables pour travailler sur un développement durable équilibré.
Le développement durable correspond à la capacité des populations locales à peser sur leur propre développement. Pour dépasser le rapport de force Nord/Sud et insuffler du changement, il faut partir des populations locales, du citoyen
Philippe MARTIN, Député du Gers, Membre de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, Assemblée nationale
Je voudrais tout d’abord préciser que je ne suis pas un spécialiste des relations stratégiques Nord/Sud. En revanche, en tant que vice-président du groupe socialiste pour l’environnement, Secrétaire national adjoint à l’environnement du Parti socialiste et membre de la commission du développement durable, je me suis intéressé depuis maintenant quelques années à ces questions, en participant notamment aux deux derniers grands sommets du Climat : Bali en 2007 et Copenhague en 2009. Je voudrais plutôt m’attacher à montrer l’approche du politique, en essayant de le faire d’une manière moins oxymore que celle de mon camarade Yves Cochet.
Je présenterai quelques réflexions avec un préalable puisque la problématique est : développement durable, instrument de dialogue ou de domination Nord/Sud ? Peut-être que dans ce domaine du développement durable, la notion de Nord/Sud n’est pas forcément la plus pertinente dans la mesure où il y a d’un côté des pays riches développés ou en développement dont certains sont des pays du Sud, et de l’autre côté des pays pauvres, qui sont peu développés. L’autre distinction que l’on peut peut-être opérer est celle des modes de vie. Si effectivement tous les pays avaient le même mode de vie que les Etats-Unis, on sait qu’il faudrait beaucoup plus de terres pour y parvenir. Le constat que nous faisons dans ces sommets est, qu’à l’évidence, nous utilisons beaucoup trop rapidement les ressources que la terre peut fournir, et que dans le même temps nous produisons beaucoup plus de déchets qu’elle ne pourra en absorber. Ce qui aboutit à cette remarque : la terre ne récupère pas du rythme auquel nous la menons. Les raisons de cette situation sont connues. Il est clair que les pays riches ont longtemps refuser de croire, ou refuser de voir, qu’un système qui est fondé sur l’accaparement sans limite des ressources naturelles, sur la production de marchandises à coût toujours plus bas, et sur des profits maximums pour un petit nombre de personnes, aboutirait à ce que les habitants des pays pauvres aient un avenir tout à fait sinistre.
La première remarque que je voudrais faire est que la question du développement durable a été d’abord un instrument de domination, plus ou moins conscient, des pays du Nord vis-à-vis des pays du Sud. Je crois qu’il est désormais impératif que, si le développement durable veut devenir un instrument de dialogue, il doit le faire sous peine alors d’être considéré comme un instrument de domination consciente des pays du Nord sur les pays du Sud. En réalité, ce que l’on constate, c’est que si on a pu faire ce que l’on a fait pendant tant d’années dans les pays riches ou dans les pays du Nord, c’est parce que les pays du Sud ne faisaient pas la même chose. Aujourd’hui nous sommes bien conscients que si les pays pauvres veulent adopter une trajectoire de développement et de croissance identique à la nôtre, cela va poser des problèmes, y compris pour les pays du Nord puisqu’effectivement nous sommes dans le même avion, aucune première classe n’existant en matière de développement durable.
Ce que j’ai remarqué également au cours de ces sommets, c’est que les pays du Sud ont compris cette situation. De plus en plus, c’était vrai à Bali et c’était encore plus vrai à Copenhague, ils ont compris que les pays riches avaient besoin d’eux, et qu’au fond leurs ressources naturelles avaient une valeur qui n’a pas toujours été quantifiée de cette façon-là. La forêt en est un exemple tout à fait probant. Geneviève Ferone disait qu’on ne peut pas adopter la stratégie de la décroissance du fait que 6 milliards de personnes doivent modifier leur comportement. Or il faut avoir conscience que d’ici à 2020, il y aura presque 2 milliards de personnes supplémentaires qui vivront dans des régions du monde où l’eau est raréfiée, que les déplacements dus aux inondations concerneront dans la même période plus de 300 millions d’individus sur cette planète. Par conséquent, je fais partie de ceux qui considèrent que les plus riches doivent malgré tout vivre de manière un peu moins dispendieuse, un peu plus sobre, si on veut rétablir un équilibre, notamment vis-à-vis des pays pauvres. Je crois que nous devons avoir un mode de vie moins égoïste, et passer d’une société du jetable à une société du réparable, qui fera le tri entre l’essentiel et le superflu. S’agissant de la préservation de la biodiversité, je crois que c’est effectivement un élément fondamental de préserver les ressources naturelles de la planète. Dans le département du Gers, nous nous battons pour que cette biodiversité perdure. C’est le département où l’expérimentation la plus forte a été faite en agro-foresterie, c’est-à-dire remettre des arbres au milieu des grandes cultures céréalières, alors que les arbres et les haies, tout ce qui assure la faune et la flore, la biodiversité, avaient disparus sous l’effet de la politique agricole commune, qui fait que plus vous avez d’hectares qui sont cultivés, plus vous touchez de primes. Faire revenir des arbres, c’est faire revenir des auxiliaires de culture que sont les insectes, et c’est faire en sorte qu’on utilise moins de pesticides.
Mais deuxième remarque est la suivante : est-ce que l’instrument « développement durable » des pays du Nord est aujourd’hui fiable, stable et utilisable comme instrument de dialogue ? Je n’en suis pas certain. Je trouve que parfois les pays du Nord ne donnent pas toujours l’image d’une résolution ferme et irréversible. Et au fond, d’une certaine façon, confondre le court et le moyen terme avec le long terme. Je voudrais vous dire cela pour que vous ayez bien l’approche que les hommes politiques peuvent avoir de cette question. Le problème du développement durable, de l’écologie, est celui du rapport entre le temps politique et le temps écologique. Le temps écologique est beaucoup plus long que le temps politique. Les hommes politiques ont pris la fâcheuse habitude de vouloir avoir les résultats de ce qu’ils décident dans le mandat qui est le leur. Et le problème de l’environnement est qu’il n’est pas comme une route dont on inaugure le début des travaux et dont on coupe les rubans dans le même mandat de façon à faire en sorte que les choses se passent bien après, puisque les hommes politiques sont comme les énergies, c’est-à-dire renouvelables. Par conséquent, ce temps politique doit être modifié. Le temps de l’écologie, c’est un temps long. Et la difficulté des chefs de l’Etat des pays riches est là. Ce qu’on demande à Nicolas Sarkozy, à Angela Merkel, à Barack Obama, c’est de prendre des décisions souvent impopulaires dans leurs pays, et qui ne donneront des résultats que lorsqu’ils seront des plaques de rue ou de square, parce qu’ils auront quitté cette planète. Croyez-moi, c’est quelqu’un qui vit la politique au quotidien qui vous le dit, c’est un changement de mentalité considérable qu’il faut obtenir. Il faut une dose d’altruisme, de don de soi, d’abandon du résultat immédiat pour faire en sorte que cela se passe. C’est une des raison qui pousse au consensus national et qui m’avait fait voter le Grenelle pour donner de la force à la France avant Copenhague. Il faut que le développement durable puisse transgresser les alternances politiques, pour obtenir des résultats qui soient efficaces.
Je finirais par une anecdote qui parle de la société du gaspillage et du jetable. En 1854, le capitaine Ward inventa le gilet de sauvetage, composé de morceaux de lièges, cousus dans une ceinture en toile. Depuis le 1er janvier 2010, si vous partez en mer à plus de 6000 des côtes, vous devez avoir avec vous un gilet de sauvetage avec de meilleurs indices de flottabilité. Cela donne effectivement satisfaction aux producteurs de ces nouveaux modèles. Mais quid des gilets obsolètes, de ces milliers de gilets fabriqués avec du nylon, des fermetures éclairs, des flotteurs en polystyrène qui vont rejoindre les décharges, les caves, les greniers et les incinérateurs ou qui vont flotter en mer ou abîmer notre espace marin ? Et bien ce pourrait être l’objet d’une nouvelle conférence de l’IRIS : résoudre la question des flotteurs du capitaine Ward, c’est peut être commencer à résoudre les problèmes du Nord et du Sud.
Serge MICHAILOF, Consultant international et enseignant à Sciences po, ancien directeur de la Banque mondiale et des opérations de l’Agence française de développement (AFD)
Face aux crises environnementales et sociales au Sud, réinventons l’aide au développement
Pendant longtemps, nous avons tous cru pouvoir négliger ce qui se passait au Sud. Certes il ne manquait pas d’évènements graves là bas. Des famines par ci, des guerres tribales par là. Mais on confiait ces difficultés à nos bonnes œuvres, nos diplomates, et s’il le fallait vraiment on envoyait un bataillon d’infanterie de marine régler ces questions. Or ce sur quoi je voudrais insister, c’est que cette époque de « benign neglect » du Sud se termine. Nous allons en effet nous trouver confrontés, tout au long du XXI ème siècle, à deux problèmes majeurs dont nos pays riches ont déjà perdu le contrôle :
En premier lieu la croissance prodigieuse des pays émergents accentue les désordres environnementaux dont nous sommes historiquement les premiers responsables. Leur prodigieuse croissance va en effet nous acculer, et ceci beaucoup plus rapidement que nous ne l’imaginions, dans l’impasse environnementale dans laquelle de toutes façons notre modèle de développement nous conduisait paisiblement. Cela va simplement aller beaucoup plus vite que nous ne l’imaginions. Je vous rappelle que d’ici 2050, sur la base des tendances actuelles, la population de la planète va s’accroître de 2,5 milliards d’habitants, ce qui correspond à la population totale du globe en 1950. Or cet accroissement de population prendra place quasi exclusivement dans les pays du Sud. Sur la base des mêmes tendances, il devrait y avoir à cette date plus de voitures (3 milliards) qu’il n’y avait d’habitants sur la planète en 1950. Déjà la Chine est le plus gros émetteur de CO2 au monde.
Regardons les choses en face : notre planète a déjà du mal à assurer, en termes de soutenabilité environnementale, le niveau de vie des 500 millions d’européens et américains qui vivent confortablement. Là-dessus est venu se greffer un nombre équivalent d’asiatiques et de latino-américains, qui tout juste sortis de la misère ont un niveau de vie disons quasi européen ; en 20 ans notre pression sur l’environnement a ainsi quasiment doublé. On sent déjà la présence de ces 500 millions de nouveaux consommateurs si on s’en tient à l’augmentation du prix à nos pompes à essence. Mais où allons nous au plan environnemental, si dans 25 ans, les classes moyennes de ces pays émergents, comme c’est leur légitime ambition, ont doublé ou triplé et représentent 1 à 1,5 milliard de personnes ? Tout ceci en laissant sur le bas coté de la route les deux tiers de la population mondiale qui aussi rêvent et rêveront toujours de manger des steaks et de rouler en voiture ?
Maintenant parlons un peu de l’autre extrémité du spectre, du milliard de pauvres gens qui sont eux au fond du trou, le « Bottom Billion » dont parle Paul Collier. Permettez-moi ici un souvenir de jeunesse. J’ai découvert Tananarive, la capitale malgache, il y a exactement 50 ans : J’étais parti en bateau stop à l’aventure ; c’était une petite ville proprette aux façades blanchies et aux rues soigneusement balayées. Or j’étais à Tananarive il y a exactement deux mois. La misère y est effrayante. Des groupes d’hommes et de femmes ressemblant à des milliers de clochards dorment à même le sol. Je ne veux certes pas dire que toute l’Afrique est à la dérive comme Madagascar. Il y a en Afrique une énorme diversité de situations. Je constate par contre dans de nombreux pays une extrême fragilité et une extraordinaire montée de l’insécurité. J’ai pendant des décennies parcouru des dizaines de milliers de kilomètres à travers des régions saharo-sahéliennes, dormant à poings fermés au bord de la piste, la voiture grande ouverte. Je constate simplement aujourd’hui que le Paris/Dakar n’ose plus s’aventurer dans le Sahara et que des travailleurs humanitaires sont enlevés par une succursale d’Al-Qaïda pratiquement à la sortie de Niamey, là où j’avais coutume de passer la nuit en famille à la belle étoile le weekend.
Or derrière cette montée de l’insécurité, je vois partout une montée des tensions, des frustrations et des rancoeurs de jeunes sans emploi, sans perspective, sans espoir sinon celui d’émigrer, et encore ils sont bien lucides sur le sort qui les attend s’ils y parviennent. Au plus profond des brousses africaines ou des montagnes afghanes j’ai vu ces jeunes regarder sur de vieilles TV branchés sur des batteries de camion nos feuilletons qui étalent notre opulence et les émissions de Al Jazeera. Derrière tout cela je vois une stagnation de ces économies de pays fragiles, conjuguée à une transition démographique à peine amorcée.
Pour résumer, d’un côté le succès des pays émergents nous accule désormais à inventer au plus vite puis à diffuser un nouveau modèle de développement, plus respectueux des équilibres environnementaux. De l’autre, la fragilisation croissante de par le monde d’une soixantaine de pays déjà vulnérables dont beaucoup sont situés en Afrique nous pose un autre type de problème. Leurs appareils étatiques ne contrôlent déjà souvent plus leurs provinces périphériques qui se transforment en zones grises où plus personne n’ose aller se promener. Bientôt les cartes du monde retrouveront leur allure du XVIIIe siècle : avec des zones blanches, véritables terra incognita. Qui circule encore au Sud Waziristan ou en Somalie ?
Entre ces pays émergents qui nous damnent le pion et les pays en « pré-crise » ou en crise, on peut considérer que pas moins de 4 milliards de personnes hésitent entre les deux options.
Or si les désordres environnementaux tels que le réchauffement climatique, les pluies acides ou l’empoisonnement des eaux par les pesticides ne connaissent pas de frontières, la montée des tensions dans les pays fragiles à économie stagnante et à démographie galopante ne pourra pas non plus connaître de frontières. Lorsque je vivais au Niger il y a 25 ans, sur les 7 millions d’habitants de la population de ce pays, environ un million devaient vivre à l’étranger, à cause d’une base agricole très fragile, et s’installaient essentiellement en basse côte, au Nigéria et Côte d’Ivoire. Aujourd’hui les Nigériens sont 16 millions et en 2050 les démographes prédisent qu’ils seront 58 millions. Or ni les Nigérians ni les Ivoiriens ne sont prêts à accueillir 10 ou 20 millions de Nigériens. S’il n’y a pas de progrès significatifs pour soutenir l’agriculture au Niger, comment et où vivront ces 58 millions de Nigériens ?
Nous avons actuellement à l’œuvre sous nos yeux, dans nombre de pays dits fragiles, des processus de désintégration sociale de grande ampleur dont nous constatons les conséquences ultimes en Afghanistan ou en Somalie. Je suis de plus en plus effrayé par la désorganisation de nombreux pays. Je vois en particulier la combinaison d’une densité humaine en forte croissance coïncider avec une gestion désastreuse du potentiel agricole, le tout conduisant à des crises malthusiennes comme cela a été le cas au Rwanda hier, comme c’est le cas aujourd’hui en Afghanistan et maintenant dans la bande saharo-sahélienne. Je vois les villes grossir sans que la moindre planification urbaine permette d’y organiser des conditions de vie décentes. Je vois des pouvoirs prédateurs piller les richesses et exclure de toute vie politique et économique certaines catégories de population pour des raisons ethniques, religieuses ou autres.
Sans doute aujourd’hui n’y a-t-il qu’un Afghanistan, qu’une Somalie, mais d’autres drames mijotent dans de dangereux chaudrons. Or soyons lucides : nous découvrons en même temps les limites de nos instruments d’action traditionnels : nos diplomates organisent des conférences, nos militaires s’embourbent. Dans cet environnement où nous assistons à la fin de trois siècles d’hégémonie occidentale, il nous faut cesser de rêver. L’aide internationale ne va pas faire disparaître la misère du monde. En revanche, sans être bien sûr une panacée, si elle est bien conçue et correctement gérée, cette aide tant décriée constitue par sa capacité à travailler sur le long terme, à gérer l’incertain et à concilier financements et appuis intellectuels, l’un des rares instruments à la disposition de nos pays riches. C’est un outil essentiel pour tenter de prévenir ou de minimiser les drames qui se préparent au Sud : crises environnementales provoquées par une croissance débridée d’une part, crises provoquées par l’implosion de certains Etats d’autre part.
Dans un tel contexte, l’aide publique au développement n’est plus une œuvre de charité mais doit devenir un instrument de géopolitique et un instrument de dialogue Nord/Sud. Une nouvelle conception de l’aide au développement doit ainsi se construire sur l’indispensable communauté d’intérêts entre Sud et Nord. Car c’est notre maison commune qui commence à brûler au Sud.
Au total cette aide doit désormais se fixer quatre objectifs :
(i) Elle doit poursuivre sa mission historique de stimulation de la croissance économique des pays à la traîne et leur faciliter le « rattrapage » des pays du Nord. Le grand enjeu sera ici certainement l’Afrique.
(ii) Elle devra aussi poursuivre sa lutte contre la grande pauvreté, et tenter d’atténuer les déséquilibres sociaux les plus criants, en amorçant, dans le cadre des objectifs du millénaire, une politique de redistribution sociale mondiale à très petite échelle, qui devra être fondée sur des mécanismes de taxation internationales.
(iii) Elle devra également désormais faciliter le renforcement des Etats fragiles et la stabilisation d’Etats « faillis » sortant de conflit, domaine où pour des raisons bien identifiées(1) ses performances ont été jusqu’ici déplorables. Son action, si elle est correctement conçue, sera certainement moins coûteuse et plus efficace que nombre d’interventions militaires.
(iv) L’aide devra enfin participer à la construction de partenariats mutuellement bénéfiques avec les pays émergents, pour amorcer une gestion responsable des biens publics mondiaux que sont le climat, l’air, l’eau, la biodiversité, les grands massifs forestiers, la santé face aux grandes pandémies. Le coût pour le contribuable de ce type d’action, qui repose essentiellement sur des transferts de matière grise et des financements aux conditions du marché, peut rester modeste.
Ces actions de partenariats devront en fait constituer l’embryon des futures politiques publiques internationales qui seront indispensables pour que nous ne soyons pas victimes, à échelle planétaire, de la fameuse tragédie des communs. Ce principe, exposé au XVIIIe siècle par David Hume, démontrait que la consommation anarchique de biens collectifs sur un espace fini les condamnait inéluctablement à la destruction. Ce qui était vrai du pâturage communal surexploité qui se transformait en désert au XVIIIe siècle, est malheureusement désormais vrai pour notre planète au XXIe siècle…
(1) “La pétaudière de l’Aide à Kaboul » Serge Michailof, Le Monde, 28 mai 2008
Ajouter un commentaire